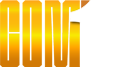À l’âge de douze ans, en 1964, placée par ses parents dans un couvent à Montréal, Marjorie Villefranche s’ennuyait à mourir et brûlait déjà de militantisme et d’envie de savoir qui elle est. « À cet âge-là, on ne connait pas vraiment sa culture », soutient la femme de soixante-douze ans aujourd’hui. C’est toute une tranche de vie qu’elle se remémore.
Une fois sortie de ce pensionnat, après cinq ans, la jeune Marjorie et a une soif identitaire débordante. C’est sa rencontre avec Adeline Chancy, dont l’appartement est considéré comme « la première Maison d’Haïti », qui lui a permis de trouver sa voie et de renouer avec sa culture.
Mme Chancy l’a invitée à faire partie de l’organisme, qui était à ses balbutiements. Elle dit avoir été « chanceuse » de faire la rencontre de cette enseignante et militante comme elle.

« En fait, je suis arrivée à la Maison d’Haïti presque à la fondation de l’organisme, mais comme une jeune femme qui avait besoin d’aide et qui se cherchait. De fait, « dans les années 1960, il n’y avait pas de Noirs comme hait pour nous », affirme celle qui dirige aujourd’hui cet organisme phare de la communauté haïtienne.
Soixante ans de militantisme
Elle a commencé bénévolement par son projet Ti pye zorany (petit oranger), une activité culturelle destinée aux enfants. « On était une bande de très jeunes parents. Et dans notre tête, on allait retourner en Haïti. Il fallait, pour nous, transmettre la culture haïtienne aux enfants pour qu’ils ne se sentent pas perdus à leur arrivée. »
Marjorie Villefranche a étudié en philosophie et en histoire de l’art, mais c’est dans le militantisme qu’elle a trouvé son chemin, sa vraie vocation. Sa première cause a été la lutte contre la déportation, en 1973, de plus de 2000 Haïtiens. Le 15 août 1973, le premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, retire aux visiteurs venus après le 30 août 1972 la possibilité de faire une demande de résidence permanente, ce qui place des centaines de ressortissants haïtiens sous le coup d’une déportation.
Une manifestation est organisée à Ottawa et Marjorie Villefranche brandit sa pancarte pour protester contre cette décision de M. Trudeau.
Ensuite, on la retrouve dans la lutte contre le racisme envers les chauffeurs de taxi haïtiens ainsi que la stigmatisation de la communauté haïtienne assimilée faussement au VIH. Au début des années 1980 (soit en 1981), Michael S. Gottlieb dans le Morbidity and Mortality Weekly Report avait évoqué la très grande fréquence de la maladie du sida parmi les immigrés haïtiens aux États-Unis.
On avait alors spéculé que la nouvelle maladie mystérieuse des 4H (Haïtiens, homosexuels, hémophiles, héroïnomanes) pouvait avoir comme origine l’île d’Haïti. Les répercussions se font sentir jusqu’au Canada, à Montréal, en particulier. Les conséquences affectaient même les funérailles des membres de la communauté haïtienne à Montréal. Les embaumeurs n’en voulaient pas, sauf Magnus Poirier. Mme Villefranche était également engagée dans la lutte contre la stigmatisation qui touche encore les jeunes haïtiens de la communauté associés trop souvent aux gangs de rue.
« On a toujours une lutte à mener tant que les personnes d’origine haïtienne immigrantes ne sont pas acceptées comme citoyens, qu’on les pousse dans des zones d’exclusion », croit la militante aguerrie.
Une adresse pour Haïti

Contrairement à ce que l’actuelle génération pourrait penser, Marjorie Villefranche ne dirige pas la Maison d’Haïti depuis si longtemps; 2010 en fait. C’est plutôt Célitard Toussaint, son « modèle », qui a mené cette maison « d’une main de maître » jusqu’à sa retraite.
« Il n’y a pas un jour qui passe sans que je pense à elle à chaque fois que je mets les pieds à la Maison d’Haïti. C’est une force tranquille, moi, je suis un peu plus… Même s’il y avait des difficultés, elle était toujours calme. », témoigne Mme Villefranche. Si Mme Toussaint a été son modèle, Adeline Chancy, quant à elle, a été sa mentore. « Adeline a une idée à la seconde et cela, je l’ai pris d’elle », ajoute‑t‑elle l’air reconnaissant. Lorsqu’on lui demande si elle compte accrocher ses pancartes bientôt ou si elle souhaite continuer, la militante répond avec nuance :
« Physiquement, pas pour longtemps, mais je serai là, dit-elle en éclatant de rire, je serai toujours là, c’est clair. La bataille n’est pas finie ».
| Prendre le pouls de son l’alma mater Au cours de sa carrière de militante au Québec, Marjorie Villefranche s’est absentée pendant une période de quatre ans pour aller travailler en Haïti avec Adeline Chancy, alors qu’elle était secrétaire d’État à l’alphabétisation. Dans les années 1980, elle a été présidente du Conseil d’administration (CA) de la Maison d’Haïti avant d’en devenir la directrice; depuis une quinzaine d’années. Elle a été embauchée par l’organisme en 1983, lors de son déménagement dans Saint-Michel, ce qui fait que c’est le quartier de Montréal qu’elle connaît le mieux. Elle était à ce moment-là directrice des programmes. Marjorie Villefranche a deux enfants et cinq petits-enfants. À l’âge de vingt ans, elle entre à la Maison comme militante. |
Rédaction : Jean-Numa Goudou, publié par admin