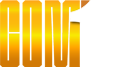Le dernier poète d’Haïti littéraire s’est éteint à 96 ans, dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, à Montréal, « mais sa lumière persistera par-delà les éternités » affirme Marc Exavier. Retour sur la vie et l’œuvre de l’auteur de Mon pays que voici, poème-témoignage qui a résisté au temps.
Par Claude Gilles*
Né à Port-au-Prince, Haïti, le 25 août 1928, Anthony Phelps est poète, diseur et romancier. Il s’est consacré à la littérature après des études de chimie et de céramique aux États-Unis et au Canada. Le poète a particulièrement marqué son temps par Mon pays que voici, « poème-témoignage qui a résisté au temps et qui, curieusement, continue à dire avec force la réalité d’un pays aux prises avec l’exploitation et l’aliénation » (Mémoire d’encrier: 2007).
Avec de grands noms de la littérature haïtienne, notamment les poètes Davertige, Serge Legagneur, Roland Morisseau, René Philoctète et Auguste Thénor, Phelps a fondé, en 1961, le mouvement « Haïti littéraire » et la revue « Semences ». Il fut aussi le principal animateur de la troupe de comédiens « Prisme » et réalisateur d’une émission sur la poésie et le théâtre sur les ondes de Radio Cacique dont il est cofondateur. Sa militance lui a coûté un séjour dans les geôles sous la dictature naissante et féroce de François Duvalier.
Relâché comme plusieurs autres miraculés des camps de la mort, Anthony Phelps a pris le chemin de l’exil. Montréal a été son refuge, sa terre de liberté et de création. Il y a fait du théâtre, de la radio et de la télé. Des passions qui ouvraient les portes de Radio-Canada au natif d’Haïti pour une longue carrière en journalisme. Après des décennies de bons et loyaux services à salle des nouvelles de la chaîne publique, Phelps a pris une retraite anticipée pour adhérer à sa vraie passion : la littérature.
L’homme de lettres est aussi connu de l’industrie cinématographique québécoise. Il a participé, en effet, à la narration de plusieurs films pour InformAction et les Productions Pierre Nadeau. Il a réalisé et produit avec le même souffle pas moins d’une quinzaine de disques de poésies d’auteurs haïtiens et québécois. Il a ainsi donné de la voix aux mots inspirés par les poètes de deux zones les plus francophones de l’Amérique (Haïti et Montréal).
Sa bibliographie est dense. Une vingtaine de titres dont certains traduits en espagnol, anglais, russe, ukrainien, allemand, italien et japonais. L’œuvre de Phelps est aussi enseignée dans des universités aux États-Unis – notamment Princeton, Saint Michael’s College (Vermont), Iowa State University – qui contiennent un programme d’études françaises. Toutes les critiques sont unanimes quant à la qualité de la poésie de Phelps.
« Pour prendre conscience de la valeur d’une œuvre, dit-on souvent, il faudrait imaginer un instant qu’elle n’existe pas. Que se serait-il passé dans la poésie haïtienne si Anthony Phelps n’avait pas écrit et publié? En quoi consiste la contribution d’Anthony Phelps à la littérature? Que se serait-il passé dans la vie de quelques écrivains de cette époque s’ils n’avaient rencontré cet homme qui, aujourd’hui, vivant loin des sirènes de la vaine gloire, mais sans retrait hautain, a produit l’une des œuvres les plus connues, les plus populaires de la littérature haïtienne? », s’interroge d’un ton admiratif Émile Ollivier, une autre référence dans la littérature haïtienne.
Plusieurs fois boursier du Conseil des Arts du Canada (bourse de création libre), Phelps a deux fois obtenu le prix de poésie Casa de las Americas, Cuba. Le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du gouvernement du Québec lui a aussi décerné, le 2 février 2011, une plaque d’honneur à l’occasion du forum « Encre noire, littérature et communautés noires ».
Anthony Phelps a eu aussi les honneurs de la Ville de Montréal, en mars 2016. Ce fut à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie ! Quand la terre trembla en Haïti, le 12 janvier 2010, le poète doublement insulaire, car il a migré d’une île à l’autre, a dit sa douleur pour son alma mater : « Mon pays a un caillot de sang dans la gorge. »
Port-au-Prince, sa ville natale, a été mise à genoux. Une ville endeuillée, couleur de sang, ravagée par les secousses telluriques. Mon pays que voici, en référence à l’un de ses recueils écrit en 1965, lui revenait à l’esprit. Phelps ne doutait pas, dit-il, « qu’en écrivant cette marche poétique à l’intérieur de l’histoire d’Haïti, je décrivais le drame qui frappe aujourd’hui mon pays ».
Prémonitoire, pour un auteur qui sait dire merci quand il est honoré ; qui sait aussi dire non merci contre l’amnésie. « Je ne saurais accepter un hommage en tant qu’auteur de Mon pays que voici, tant et aussi longtemps que Jean-Claude Duvalier ne sera pas traduit en justice », a écrit le poète pour refuser un hommage in abstentia du désormais ex-président Michel Martelly. Fils de dictateur, tyran lui aussi, Baby Doc passa, finalement, l’arme à gauche sans jamais être inquiété par la justice. Et pour cause…
*Le texte initial a été publié le 1er avril 2016 dans Le Nouvelliste
Note: L’écrivain et poète haïtien, Anthony Phelps, auteur du célèbre recueil et disque Mon pays que voici, a été reçu à l’hôtel de Ville de Montréal, en 2016, pour un hommage soutenu. Le président du conseil de ville à l’époque, Frantz Benjamin, lui aussi poète, a profité de la Journée mondiale de la poésie pour glorifier, dit-il, « un homme exceptionnel qui a marqué tant de vies, des Montréalais, des Haïtiens ».