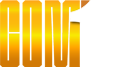Le travail d’un chercheur pourrait consister, à l’occasion, à changer les paradigmes. « Une place au soleil. Haïti. Les Haïtiens et le Québec », essai de Sean Mills, paru chez Mémoire d’encrier, renverse ainsi les perspectives.
Par Claude Gilles*
Quelque huit décennies après l’établissement des premiers Haïtiens au Québec, l’historien Sean Mills consacre un ouvrage entier à ce peuple de migrants qui façonne son ascension dans la société d’accueil. Dans cet essai, l’auteur s’appuie sur une riche documentation pour aborder la manière dont les migrants haïtiens des années 1930 aux années 1980 ont marqué le débat sur les problématiques de cette longue période : langue, classe, nationalisme, racisme, sexualité, etc.
Ces thématiques sont explorées par le biais d’un chevauchement historique des sociétés du Québec et d’Haïti. Mills raconte ainsi une histoire fascinante et inédite ayant trait aux deux plus grandes sociétés francophones des Amériques. Il souligne à l’encre forte l’intense lutte menée par la communauté haïtienne contre le racisme et l’exclusion. Le chercheur entame son travail de recherches en abordant la question du racisme, omniprésent dans l’industrie du taxi de Montréal.
Nous sommes au début des années 1980 quand « les chauffeurs de taxi haïtiens se voient refuser du travail ou sont congédiés massivement par les entreprises desservant des clients blancs exigeant un chauffeur non noir » (2016: p. 7). Les autorités de l’aéroport de Dorval, à l’époque, consentaient même à modifier les règlements pour mieux exclure les Haïtiens de l’industrie du taxi. Une organisation créée par les Haïtiens actifs dans cette industrie diligenta des études assorties de réflexions sur les arts, la politique et la philosophie pour empêcher leur exclusion (ibidem).
Pour montrer l’influence de la presqu’île caribéenne sur le Québec, Mills revient sur la conception qu’on a eue sur les immigrants dans la province canadienne. Ces derniers ont été perçus par certains comme « une menace pour le tissu social de la nation » (p. 8). D’autres les considéraient, écrit Mills : « comme une composante essentielle du développement national (ibidem). Le débat sur les immigrants noirs était davantage corsé. Ces derniers étaient rarement considérés comme des sujets actifs de la politique et de la pensée. »
Renveser le paradigme
En se fondant sur des travaux de David Austin, l’auteur de « Une place au soleil : Haïti, les Haïtiens et le Québec » voit l’ombre immense de l’esclavage, ou encore de l’impérialisme et du colonialisme dans la façon de considérer les migrants noirs qui forçaient les barrières les empêchant de prendre leur place au soleil. Entre deux faits historiques, Mills fixe l’objectif de son essai qui n’est autre que « d’offrir une nouvelle façon de penser les relations entre migration, histoire et politique (p. 8).
Le chercheur contextualise son travail en décrivant l’arrivée massive dans les années 1960 des migrants du sud global au Québec. Ces derniers se projetaient progressivement dans l’espace public (politique, culturel…) québécois. Les années avant 1960, rappelle l’historien, étaient considérées comme une période d’isolement culturel. Les modèles d’intégration, à ladite période, se définissaient à partir de l’hypothèse d’une perte de la langue et de la culture des immigrants (Portes et Rumbaut, 1996 : 247-248).
Pour renverser le paradigme, Mills soutient que « l’héritage de ces années continuera à influencer le climat dans lequel les migrants arriveront après 1960 » (p. 9). Ce professeur d’histoire à l’Université de Toronto estime que l’importance tant symbolique qu’intellectuelle d’Haïti dans l’histoire du Québec est méconnue.
Haïti dans l’imaginaire du Canada français
Auteur de divers travaux sur des questions d’empire et de la pensée postcoloniale, Mills écrit : « De tous les pays du Sud, Haïti est celui qui occupe depuis longtemps la plus grande place dans l’imaginaire du Canada français. Au cours de la période tumultueuse des années 1930, puis lorsqu’éclate la guerre en 1939 et que la France capitule en 1940, les intellectuels canadiens-français et les membres de l’élite haïtienne voyagent les uns chez les autres et cherchent à renforcer leur position dans les Amériques en se définissant comme faisant partie d’une même grande culture latine et catholique dans l’hémisphère » (ibidem).
Dans les sept chapitres de son livre divisé en deux grandes parties, Sean Mills estime qu’Haïti et le Québec sont intimement liés par la langue française entre autres. Les Québécois le sont surtout avec les Haïtiens arrivés en grand nombre dans les années 1960, marquant la naissance de la dictature déjà féroce de François Duvalier, ce médecin ayant accédé au pouvoir en prétendant représenter les intérêts des Noirs pauvres constituant la grande majorité de la population.
Duvalier, roi de l’exil
Le tyran qui préféra la hache du boucher au bistouri créa une milice armée pour consolider son pouvoir. La violence de la dictature des Duvalier (1957-1986) établie en Haïti pousse certains citoyens, dont des intellectuels, à s’exiler dans les Caraïbes et au Canada. Depuis l’effondrement de cette dictature, l’immigration des Haïtiens au Québec change de profil. Des travailleurs qualifiés ou non spécialisés s’y installent massivement. Une génération de Québécois d’origine haïtienne renforce avec le temps cette communauté caribéenne forte de quelque 150 000 personnes dans la Belle Province.
Pour aborder les différentes problématiques (langue, race, pouvoir, migrants et frontières, etc.), Mills se réfère à une dense bibliographie. Il fouille aussi dans les archives informelles de groupes communautaires, notamment dans celles du Bureau de la communauté de Montréal et de la Maison d’Haïti. Le chercheur diversifie ses sources en utilisant, entre autres, essais historiques, romans et nouvelles.
Pour aborder, par exemple, la problématique de la libération sexuelle au Québec, l’auteur se réfère à « Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer » de Dany Laferrière, écrivain d’origine haïtienne. Quand on a appelé, dans les années 1960-1970, à une libération sexuelle au Québec, on évoqua les questions liées aux désirs et aux rapports sociaux d’une nouvelle communauté noire. Et le livre du désormais académicien, Laferrière, déclencha une controverse sans fin.
Auteur de plusieurs travaux récompensés pour leur originalité, Sean Mills met en circulation un ouvrage faisant déjà référence à un sujet qui n’est pas négligeable : comment l’histoire d’un pays du Sud marque-t-elle celle d’une province d’un pays occidental? Grâce à sa grande compréhension du sujet, l’auteur jette un regard juste et perspicace sur une « minorité visible » ayant tout de même fière allure.
_____________________ Sean Mills, traduction d’Hélène Paré, Mémoire d’Encrier, Montréal, 2016, 369 pages.