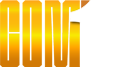Qui est Noir? Question pertinente du professeur agrégé à l’École de psychologie (Université d’Ottawa), Jude Mary Cénat, initiateur du Centre interdisciplinaire pour la santé des personnes noires et également directeur du Laboratoire de recherche vulnérabilité, trauma, résilience et culture.
Dans un article scientifique*, publié en anglais, à la mi-juillet, il montre « l’urgence de définir avec précision la population noire dans le cadre de la recherche en santé au Canada ».
L’auteur constate entre autres que des études en particulier une à laquelle l’on se réfère assez souvent pour parler du cancer chez la femme noire « ne rapportent pas vraiment les données exclusivement fiables auprès des personnes noires ».
Vous identifiez-vous comme « Africain, Caribéen ou Noir »? demande-t-on souvent lors des enquêtes sur la santé et dans les questionnaires administratifs. Or, « les gens peuvent être Africains et Blancs ou Arabes, ou Caribéens et Latinos ». Pour preuve, M. Cénat se présente comme Caribéen, Noir et Latino-américain.
Ce manque de données précises entraine évidemment des conséquences en termes d’intervention et de prévention en santé. « Nos programmes ne sont pas efficaces, explique le chercheur à Radio-Canada. Ils ne permettent pas de prévenir des maladies qu’on pense constater chez les personnes issues de la communauté noire parce que tout simplement nous ne savons pas les définir ou les personnes que nous définissons comme personnes noires ne le sont. »
Parmi les gens qui se considèrent comme Noirs, il faudra clarifier, selon lui, des facteurs supplémentaires tels que le pays d’origine et d’autres aspects de l’ethnicité.
Le professeur avance que « l’incapacité de trouver un terme commun pour décrire les Noirs dans la recherche en santé au Canada peut perpétuer les inégalités et entraver la recherche utile sur la santé des Noirs au Canada ».
À propos des « inégalités », soulignons que l’expression « minorité visible » tire son origine des discussions sur cet enjeu de taille sur le plan sociopolitique. Elle est utilisée à partir de 1975 par Kay Livingstone et devenue norme de Statistique Canada depuis 1986. Ce terme fait référence aux personnes racisées, c’est-à-dire non blanches et non autochtones. D’où l’adoption de la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui vise à faciliter l’accès équitable aux emplois pour les groupes discriminés.
En tête de liste, « Noir », dans la logique de la législation canadienne, est défini par la couleur de sa peau (critère physique) contrairement aux autres groupes identifiés par leur appartenance nationale ou ethnoculturelle.
Depuis 2010, l’enseignant Patrick Moreau a montré que l’expression « minorité visible » était « un jargon qui est non seulement inopérant, mais aussi contre-productif [sic] ». « Sous prétexte de lutter contre une discrimination raciale, en fait présumée, la société canadienne risque de faire sienne ce que Lévi-Strauss appelait une “doctrine raciste à l’envers” », a-t-il écrit dans son texte « Êtes-vous invisibles? » Ce texte est publié dans le dossier L’infâme de notre temps : le jargon! de la revue Argument.
Critiqué pour l’usage de ce terme bourré de lacunes, Statistiques Canada en est conscient, mais a décidé de le conserver dans le recensement de 2021. Pourtant, l’élaboration de nouvelles méthodes faciliterait une meilleure représentation des groupes racisés et diversifiés.
Au-delà de l’étiquette identitaire et de l’absence de données précises et détaillées dans les études sur la santé de la population noire, continuons d’agir au nom de la dignité humaine. Restons zen. Et soutenons-nous les uns les autres afin de mieux faire face convenablement aux obstacles systémiques.
* Disponible sur le site web du Canadian Medical Association Journal.