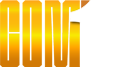Conseillères municipales de la Ville de Longueuil, originaires de la République démocratique du Congo, Affine Lwalalika et Reine Bombo‑Allara n’ont pas que des incontournables caractéristiques de leur culture en commun. Elles s’enracinent aussi dans la diversité. Entretien croisé de deux femmes politiques, noires, mères de famille et immigrantes.
Par Jean-Bart Souka
Vous avez pris part, en février dernier, à la table ronde des personnalités politiques noires du Québec. Et, selon les chiffres, elles sont une trentaine, dont deux sénatrices, dans les divers paliers gouvernementaux. Deux tiers sont des femmes. De plus, trois femmes noires au conseil municipal de Longueuil – vous-mêmes et Rolande Balma – y sont représentées. Pouvez‑vous nous retracer brièvement vos parcours respectifs?
Affine : Je suis conseillère municipale de la Ville de Longueuil, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, dans le district du Parc-de-la-Cité. Je suis également membre du comité exécutif, responsable de la culture et des communications, de la famille, de l’immigration et des relations interculturelles ainsi que de la condition féminine.
Titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal, j’ai d’abord œuvré dans le domaine financier avant de travailler d’abord, en 2017, au cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec. J’ai été adjointe exécutive de la mairesse de Longueuil et de son directeur de cabinet pendant près de deux ans. J’ai ensuite travaillé à la Ville de Brossard comme responsable des affaires institutionnelles et publiques de la mairesse.
J’ai toujours été une personne engagée dans la collectivité. Je me suis impliquée dans le mouvement citoyen Sécurité ferroviaire Rive-Sud, et j’ai aussi été coordonnatrice du comité immigration et intégration pour la Communauté congolaise de Montréal, soit la deuxième plus grande communauté noire dans la région métropolitaine de Montréal.
La politique m’a trouvée en 2015, lorsque j’étais en congé de maternité, alors que je n’y avais jamais nécessairement rêvé. À cette époque, des députés fédéraux m’ont contactée pour que je puisse m’impliquer avec eux dans leur campagne et j’ai eu, à ce moment-là, la piqûre.
Ensuite, c’est en 2021 que Catherine Fournier, la mairesse actuelle, m’a approchée pour joindre son équipe. À la suite de la campagne, j’ai donc été élue conseillère municipale de Longueuil, en novembre 2021.
Je vis à Longueuil avec mon conjoint et mes deux jeunes filles et cela fait d’ailleurs partie des raisons derrière mon saut en politique municipale. Je voulais représenter le changement dont j’ai toujours rêvé pour ma ville et mes enfants.
Reine : Depuis les dernières élections de novembre 2021, je suis conseillère municipale de la Ville de Longueuil, dans l’arrondissement du Vieux‑Longueuil, dans le district de Georges-Dor. Je suis également responsable associée de la vie communautaire et de la condition féminine et responsable des relations internationales et du protocole. J’ai œuvré à titre de présidente du conseil de la Ville de Longueuil, de novembre 2021 à mars dernier, où j’ai pris le relais à titre de présidente du conseil d’agglomération.
Mon implication communautaire a commencé à l’école secondaire de mon garçon, en 2018. À l’époque, je siégeais au conseil d’établissement de cette école. J’ai été représentante à la Commission scolaire, et ensuite commissaire scolaire.
En 2021, la rumeur planait que Catherine Fournier pensait se présenter comme mairesse de Longueuil. Je lui ai alors envoyé un message pour lui proposer ma candidature au sein de son équipe.
À l’issue d’une rencontre d’environ 45 minutes, il y a eu un coup de cœur mutuel. Une deuxième réunion via la plateforme Zoom s’est tenue au cours de laquelle, Catherine me proposait une place au sein de son équipe.
Vos histoires d’immigration canadienne sont inspirantes et contiennent des points de similitudes. L’une est arrivée à Longueuil avec sa mère et l’autre, à dix-sept ans, sans ses parents. Pouvez-vous partager des lectrices et lecteurs quelques anecdotes?
Reine : Je suis née en République démocratique du Congo, en 1987. L’année suivante, j’atterris à Longueuil avec maman et ma grande sœur. Ma maman a fait ses études au Collège LaSalle, en commercialisation de la mode, puis a complété un baccalauréat, en gestion de production à l’UQAM. Vous comprendrez ma très grande fierté à représenter les citoyennes et les citoyens de George-Dor, district même dans lequel j’ai emménagé il y a trente-cinq ans.
L’immigration venant avec son lot d’enjeux, c’est un quartier très défavorisé qui nous a ouvert les bras lors de notre arrivée. D’ailleurs, c’est à mon école que le Club des petits déjeuners a offert son tout premier déjeuner, le 1er novembre 1994. L’école Lionel-Groulx avait été sélectionnée pour nourrir les enfants qui arrivent à l’école le ventre vide. C’est là où j’ai grandi, et c’est pourquoi j’ai un grand besoin de redonner.
Ma mère a conjugué les études et le travail – parfois deux emplois – pour s’assurer que nous ne manquions de rien. Ça a permis à ma sœur et moi de nous épanouir, de devenir entrepreneures, propriétaires d’édifices, universitaires et plus encore.
Affine : Mon histoire est un peu similaire à celle de la mère de Reine. C’est quand j’avais 17 ans que ma famille et moi avons immigré pour la première fois. Ensuite, mon frère et moi avons immigré, seuls – sans nos parents – à Montréal, en 2001. Il fallait que je m’occupe de mon frère, que je m’assure qu’il ne sombrait pas dans de mauvaises voies. C’est la guerre et les conséquences du coup d’État qui a eu lieu en République démocratique du Congo DC, notre pays d’origine, en 1997 qui nous ont poussés vers l’immigration.
Comme la mère de Reine, je suis retournée à l’université. J’avais déjà, à l’époque, une petite fille de deux ans et demi. Et, moins de deux mois après mon retour aux études, j’ai su que j’étais enceinte. Je ne pouvais pas cesser de travailler, parce que j’avais des factures à payer et une famille à nourrir. Je faisais alors du temps plein au boulot, du temps plein à l’université pendant que j’avais une fille à m’occuper, de surcroît enceinte. Mais, j’ai obtenu mon diplôme en droit.
Quelles sont les raisons qui vous incitent à vous engager en politique?
Affine : Quand j’ai voulu m’impliquer en politique, je n’avais aucun visage qui me représentait. J’ai donc été parmi les rares jeunes femmes noires à s’impliquer en politique jusqu’à ce que Dominique Anglade ait fait son entrée.
Alors, je me disais : enfin une femme qui me ressemble, une maman aussi! Et un visage auquel je pouvais m’identifier!
Je voulais être la représentativité dont je rêvais. Je voulais l’être pour les jeunes filles, pour mes filles. Voilà ce qui inspire mon implication.
Existe-t-il à l’époque des figures féminines qui vous ont inspirées?
Affine : Ma plus grande inspiration est ma mère. Courageuse, persévérante, fonceuse, travaillante, débrouillarde, créative, visionnaire, elle a forgé la femme, la maman, la femme politique que je suis. Aujourd’hui encore, c’est ma plus grande conseillère et confidente.
Ayant vécu à la ville du Cap (Cape Town), Afrique du Sud, j’ai beaucoup admiré et suivi la vie de Miriam Makeba, une chanteuse sud-africaine, enfant de l’Apartheid – autrice de la chanson à succès planétaire, Pata Pata –, militante panafricaine, qui s’est engagée pour la défense des droits civiques en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle a été contrainte à un exil qui durera 31 ans, en raison de son apparition dans le film anti-apartheid Come Back, Africa.
Dominique Anglade m’a été d’une grande inspiration également. À 24 ans, ingénieure, elle dirigeait déjà un département d’une centaine d’employés dans une entreprise ontarienne. Une femme ingénieure œuvrant dans un monde d’homme à cette époque, qui est restée impliquée dans son pays d’origine, et dont les obstacles de la vie ont eu peu d’emprise sur celle qui a été vice‑première ministre du Québec, et cheffe d’un des plus vieux partis politiques du Québec.
Selon vous, quelle est l’importance d’intégrer la diversité dans les tables décisionnelles?
Affine : La diversité est plus que nécessaire sur les tables décisionnelles. Nos villes sont cosmopolites et recèlent une grande diversité. Pour être en mesure de desservir la population et offrir des services adéquats aux citoyennes et aux citoyens, il faut s’adapter aux enjeux qui évoluent et se complexifient avec le temps. La diversité est fondamentale, il faut évoquer les conditions des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap, etc.
Reine : L’inclusion des personnes noires, des femmes, des jeunes, est primordiale en politique. Ça permet d’alimenter les réflexions et d’obtenir des perceptions et des angles différents sur certains sujets et situations.
Le Mois de l’histoire des Noirs a été célébré, pour la première fois en 2022, à Longueuil, à la suite d’une résolution en conseil municipal. Par cette initiative, les élu(e)s espèrent notamment sensibiliser la population locale à la contribution de la communauté noire à l’histoire de Longueuil. Parviendrez-vous à atteindre les objectifs fixés, du moins partiellement?
Affine : À Longueuil, nous n’avions jamais eu de table ronde dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. En tant que responsable des relations interculturelles, j’ai évoqué ce manquement. La Ville, depuis deux ans, a convenu d’allouer un budget spécifique à la programmation mettant en valeur la contribution des Noirs en général sur notre territoire. Des artistes et des entrepreneurs issus des communautés noires ont ainsi été mis de l’avant.
Au-delà de la représentativité, existe-t-il des enjeux spécifiques aux Noirs? En tant que conseillères municipales, avez-vous pris des initiatives pour promouvoir davantage la diversité au Québec?
Affine : Si on regarde les noms donnés aux édifices, aux rues, il n’y a pas, ou très peu, de représentativité féminine ni de diversité culturelle. J’ai donc proposé une initiative à mes collègues ainsi qu’au comité de toponymie. Récemment, nous avons statué sur le nom de Josette Jacques, malheureusement décédée, qui a été présidente du Regroupement des femmes d’origine haïtienne de la Montérégie. J’ai proposé son nom au comité de toponymie afin qu’il soit attribué à une rue, un parc ou un bâtiment de Longueuil dans l’objectif d’honorer sa mémoire.
Alors bientôt, nous aurons le nom d’une femme noire sur l’une de nos infrastructures.