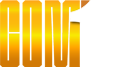Féministe, courtier immobilier et directrice adjointe de la Maison d’Haïti, Guerda Amazan est la rédactrice invitée de la onzième édition de COM1. Elle évoque, pour l’occasion, la crise de logement qui affecte de manière disproportionnée les femmes au Québec et au Canada.
Par Guerda Amazan
Dans le tourbillon mouvementé du marché immobilier québécois et canadien, une voix émerge avec une urgence croissante : celle des femmes! Derrière les chiffres et les politiques se cachent des réalités criantes, des injustices profondes que la crise du logement exacerbée met en lumière de manière incontestable.
Les statistiques révèlent une situation alarmante. Selon les données du recensement de 2021, un quart des locataires au Québec consacrent plus de 30% de leur revenu aux frais de logement, contre seulement 10% chez les propriétaires. Et parmi ces locataires, près d’un sur dix consacre même plus de la moitié de son revenu à ces frais. Ces chiffres, loin d’être de simples données, reflètent une réalité quotidienne difficile pour de nombreuses femmes.
La crise du logement impacte de manière disproportionnée les femmes, et ce, de multiples façons. Pour celles qui sont victimes de violence conjugale, trouver un logement sûr et accessible peut être une question de survie. Les mères monoparentales se retrouvent souvent confrontées à l’angoisse de ne pas pouvoir offrir un toit stable à leurs enfants. Et pour les femmes immigrantes ou autochtones, les barrières linguistiques, culturelles et économiques rendent l’accès au logement encore plus compliqué.
Cette crise ne se résume pas à des chiffres et des pourcentages. Elle entraîne des conséquences profondes sur la vie quotidienne des femmes. Subir des conditions de logement insalubres, faire face à des hausses de loyers incontrôlées, ou encore être confrontées à la violence et au harcèlement de la part de propriétaires ou de voisins sont autant de réalités auxquelles de nombreuses femmes sont confrontées au quotidien.
Pour véritablement faire progresser la cause des femmes en matière de logement, il est nécessaire de s’attaquer aux racines profondes de cette crise. Cela signifie adopter des politiques de logement qui reconnaissent et répondent aux besoins spécifiques des femmes, notamment en ce qui concerne les logements sociaux, les mesures de lutte contre la violence conjugale et les programmes d’aide au logement pour les mères monoparentales. Il est nécessaire de s’attaquer aux racines profondes de cette crise. Cela implique d’adopter des politiques de logement qui reconnaissent et répondent aux besoins spécifiques des femmes, en prenant en compte leur diversité et leurs réalités particulières.
De nombreux organismes communautaires et groupes de défense des droits se mobilisent pour offrir un refuge et un espoir à celles qui en ont le plus besoin. Des initiatives telles que la création de logements de transition pour les femmes en situation d’itinérance, le logement des femmes actives dans l’industrie du sexe, incluant celles étant engagées dans des démarches de sortie de la prostitution, par l’organisme Un Toit pour elles, la sensibilisation du grand public à travers le Mois d’activités féministes de la Maison d’Haïti, l’élaboration de guides pratiques pour une approche féministe du logement par le Projet d’habitat collectif Angela.D dans CALICO ou le développement du logement axé sur les femmes avec la Trousse à outils par BC Society of Transition Houses Automne 2023, témoignent de cette volonté.
De plus, il est crucial d’investir dans des initiatives qui visent à autonomiser les femmes sur le plan économique, en leur offrant des opportunités d’emploi et de formation qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille de manière indépendante. L’autonomie financière est un élément clé pour sortir de la spirale de la précarité et de l’instabilité qui caractérise trop souvent la vie des femmes marginalisées de changement.
Il est également essentiel de reconnaître le rôle crucial que jouent les femmes dans la recherche de solutions à cette crise. Leur expertise, leur expérience et leur voix doivent être pleinement intégrées dans les processus de décision et de planification, afin de garantir des politiques et des programmes qui répondent véritablement à leurs besoins.
En outre, il convient de souligner la difficulté pour les femmes d’accéder aux capitaux dans un système bancaire où l’octroi de prêts est souvent plus facile pour les personnes déjà aisées que pour celles qui cherchent à accéder à la propriété. Avec des salaires souvent inférieurs à ceux de leurs collègues masculins, les femmes rencontrent des obstacles supplémentaires pour exercer ce droit fondamental. Plusieurs arguments en faveur de la protection constitutionnelle du droit à la propriété ont été avancés.
Tout d’abord, il y a le précédent historique. Le droit à la propriété a joué un rôle primordial dans l’évolution de la société canadienne et constitue, en fait, une composante essentielle de la démocratie parlementaire britannique. On peut retracer ce droit jusqu’en l’an 1215, année où fut signée la Grande Charte. Le droit de posséder un bien fut également inclus dans le Bill of Rights britannique, en 1689. En 1948, le Canada a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Organisation des Nations-Unies (ONU). et dont l’article 17 stipule que : Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Le droit à la propriété est également reconnu dans la Déclaration canadienne des droits, adoptée en 1960.[1]
La crise du logement ne peut plus être ignorée ou minimisée. Nous devons reconnaître et affronter l’impact disproportionné de cette crise sur les femmes, et prendre des mesures concrètes pour y remédier en répondant à leurs besoins pratiques et spécifiques. Une approche intersectionnelle serait bien adaptée à cette crise de logement dont les impacts sur les femmes sont multidimensionnels. Cela ne sera pas facile, mais c’est une lutte que nous devons mener ensemble, avec détermination et solidarité, pour garantir un avenir meilleur et plus juste pour toutes les femmes vivant au Québec et au Canada.
[1] LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ ET LA CONSTITUTION
Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Octobre 1991