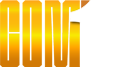À Montréal, Faubert Bolivar chauffa, le soir du 5 novembre 2022, les planches du Collège Ahuntsic avec sa nouvelle offrande, Jesika, en grande première internationale.
Par Renel Exentus*
Accompagné du musicien David Bontemps, des comédiens Roc Edenne et Jeff Édouard Chéry, l’invité d’honneur du quatrième FestiThéâtreCréole continue d’approfondir sa sphère théâtrale avec son indéniable talent et son regard perçant sur la violence sociale.
Écrite en 2009, Jesika – titre de la pièce – est jouée pour la première fois. C’est une œuvre inédite, bien que la disposition typographique ait été mise à jour. Tout se déroule dans un décor marqué par un clair-obscur. Dans la scène principale, Bolivar, dans le rôle de Bousiko, se livre à un monologue avec la mort comme toile de fond. Pendant près d’une heure, son verbe ensorcelant recrée tout sous le signe du deuil. Les éléments de la vie quotidienne ne prennent sens qu’en se convergeant vers le tourbillon de la mort.
Le jeu musical de Bontemps amplifie, pour sa part, l’aspect funèbre de la scène, plongée dans une obscurité muette et tamisée par des miroitements lumineux. Vêtu d’un costume simple aux couleurs de deuil, Bolivar, par son gestuel, outrepasse la scène. En effet, les gestes du comédien semblent s’étendre au public, au point que celui-ci participe au jeu théâtral. Faisant corps avec les sonorités musicales, le public ajoute sa voix au discours rythmé du comédien. Il complète la typologie des cadavres et se prononce sur les causes de la mort. La mise en scène sert d’opportunité de réécriture de l’œuvre, à l’aide de voix venant de toutes parts.
Si le monologue occupe les trois quarts de la mise en scène, il se révèle insuffisant pour décrire tous les méandres de ce fond mortuaire. L’obsession de la mort ne vient pas d’un simple choix esthétique : elle découle de l’histoire tragique de Jesika et de Bousiko, qui ont fait l’expérience-limite de l’insécurité dans l’intimité de leur corps et de leur maison. La tragédie vient avec le surgissement d’un zenglendo (malfrat, en français) dans leur vie, qui a non seulement emporté l’essentiel de leur fortune, mais a aussi violé Jesika, avant de l’exécuter.
Le récit se déploie dans un mouvement circulaire, où la fin se trouve déjà dans le commencement.
La deuxième scène se caractérise par l’entrée d’Edenne Roc dans le rôle de Jesika. Elle présente un Bousiko protecteur, cherchant à assurer la sécurité de son amante, Jesika. Entretemps, Jeff Edouard Chéry, dans la posture du zenglendo, surgit à la troisième scène, livrant les raisons pour lesquelles Bousiko sombre dans la folie. Sous le choc de la violence extrême, il devient, depuis lors, un apôtre du néant.
Tous les éléments de la vie quotidienne se transforment dans son esprit et prennent le visage insigne de la mort. La puanteur mortifère embaume tout : aussi bien les relations sociales que les accoutrements individuels.
La pièce prend fin dans un dialogue de l’amant, éprouvé avec le cadavre mutilé de Jesika. Ce deuil s’impose comme un incontournable. Le socle de l’existence du veuf semble désormais ébranlé. La froideur du corps ensanglanté pousse l’amant au délire, au point qu’il égrène les mots à l’infini. Comme un pansement, la parole débridée de Bousiko s’apparente à une tentative désespérée d’une âme endolorie, vacillant à la frontière entre la folie et la mort.
La mise en scène de Jesika réussit le pari de scruter la psychologie d’un personnage, qui a vécu la violence extrême. En tissant un lien entre l’individu et l’Homme, elle tente de jeter un nouvel éclairage sur les conséquences de la violence dans la vie sociale.
* Renel Exentus est diplômé en philosophie à l’École Normale Supérieure, doctorant en études urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique.