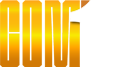La grande rupture avec la musique dite savante, Gifrants l’a amorcée dès l’âge de l’adolescence. Sa façon d’africaniser ou de retrouver l’âme haïtienne dans la musique classique est codifiée, partitions à l’appui, dans un concept dénommé « natif ». Spirituellement engagé, ce passeur de mots et de notes intègre les musiques rurales et vodou sur une polyrythmie contrastée. Le concept est développé dans une riche discographie. Portrait d’un gardien de la mémoire musicale.
Par vocation, Gifrants, de son vrai nom Marcien Guy Frantz Toussaint, est un griot. La gerbe de notes de ses mélodies trouvant leur essence dans le folklore haïtien est un subtil cocktail constituant une réponse musicale à la velléité latente de ghettoïser, voire de domestiquer le monde rural. Troubadour du métro pendant de longues années à Boston, il a su se créer une petite niche aux États-Unis avant de déménager au Québec. L’univers culturel bostonien appréciait le concept musical proposé depuis deux décennies par celui que Cap-Haïtien a vu naître le 10 janvier 1957. Quelques éléments de cet univers souvent sourd aux cris de l’humanité chérissaient le « natif » de Gifrants. Une haie d’honneur pour le gaillard (1,77 m).
Une belle reconnaissance aussi de son concept codifié, partitions à l’appui et illustré au fil des ans par une vingtaine d’albums. Témoignage vivant de la beauté et de la diversité du patrimoine culturel haïtien.
« Pinnalaganash, Volim III & Sètfwasèt, Konbinezon No. 1 », le double titre d’un de ses albums parus en 2014, aspire au référentiel et au formalisme. Le référentiel largement théorisé par Claude Dauphin « cherche à relier l’œuvre à des événements extramusicaux : pittoresques, religieux, géographiques, dramatiques, etc. Son usage est commun dans la musique descriptive ou la musique à programme. Gifrants se place dans cette tradition avec son Pinnalaganash, néologisme facétieux inspiré du créole Kinagalaganach, signifiant tiens bon la bride (…). Le versant formaliste du titre Chantrèl, titre référentiel pour musique écrite pour un quatuor, renvoie déjà, au contraire, à la structure interne de l’œuvre musicale. Ce mot désigne la voix supérieure de la mélodie ».
Le disque, pris en exemple par Dauphin – musicologue d’origine haïtienne –, à commencer par le double titre, plonge ses racines dans le rara, le monde rural de la première république des esclaves révoltés.
Le concept « natif »
La musique, depuis toujours, est l’élément accompagnateur de la société haïtienne. Une société à tradition orale. Une musique de champs, une musique de révolte, une musique pour la consolation des gémissements…une musique aussi pour la génération « Y », plus évoluée grâce à l’apparition d’Internet et des réseaux sociaux. Tout musicien essaie donc de se construire une base de sympathisants dévoués. En fusionnant la musique rurale, ancestrale… avec des genres dissemblables, Gifrants parvient à jeter les bases conceptuelles de son « natif ».
Pour arriver à ses fins, il a séché ses cours à la faculté de Droit et des sciences économiques de l’Université d’État, à Port-au-Prince, et rentre astucieusement au Cap-Haïtien. Une débauche de bonheurs à la suite d’une immersion dans des temples vodous. En cherchant à comprendre la musique populaire haïtienne, il poussa la débauche jusqu’au bout. Ses soirées en lien au culte de lignage se prolongeaient jusqu’au petit matin avec reines chantrèl et siwèl de Lafosèt, quartier populaire de la cité christophienne.
Jeune universitaire à l’époque, il chercha l’« âme haïtienne ». Le terrain ethnographique lui a donc permis d’étudier un pan entier de la culture haïtienne. Il retrouva ainsi les traces de la musique classique haïtienne et appréhenda les différences sociales et identitaires de façon intersectorielle. Gifrants écouta, en conséquence dans ces lieux, les prières et les incantations vodouesques et par la suite fit entendre les reines chantrèl.
À treize ans, encadré par un cousin musicien, Gifrants commença à jouer de la guitare. En plus de profiter des conseils d’un père guitariste, il a suivi des cours de musique, entre autres, au Collège Notre-Dame. Nikòl Lévy (Ndlr : décédé en juin 2020), ex-directeur musical de Septentrional, fut l’un de ses professeurs.
À Port-au-Prince, il a été présenté à la junte musicale par son cousin Boulo Valcourt, guitariste et chanteur réputé (mort en novembre 2017). Poursuivant son travail avec passion, le natif de Cap-Haïtien se révéla en 1977, l’année où il remporta successivement le premier prix aux concours de la fête de la Saint-Valentin et de la fête des Mères organisés par la Radio nationale d’Haïti. Un déclic pour lui qui allait lui faire rencontrer Gérald Merceron, critique et musicien de jazz notoire. Cette rencontre allait constituer un tournant dans la carrière de Gifrants.
« Merceron m’a écouté chanter pendant 90 minutes. Il pouvait constater que je faisais bon usage des accords dissonants et des progressions. Mais il m’a conseillé d’approcher la musique d’une façon scientifique, se rappelle notre interlocuteur. Il m’a parlé des modes en jazz, notion que je ne connaissais pas à l’époque. Au seuil de sa porte, à la fin de l’entrevue, il m’a dit que la logique de la musique haïtienne défiait celle de la musique occidentale. Cette affirmation reste gravée dans ma mémoire ».
« L’âme noire »
Quelques années après, soit en 1982, le musicien autodidacte laissa son île natale et alla s’établir aux États-Unis. Arrivé à New York, il rencontra son ami Jean-Baptiste Édouard, ancien musicien de l’Orchestre Septentrional. Ce dernier lui conseilla d’entrer en contact avec Nikòl Lévy, son ancien professeur de musique avec qui il cofonda Sakad. À ce duo s’ajouta Ronald Félix. Ils furent des avant-gardistes du mouvement racine.
Des divergences d’idées avec ses compagnons le poussaient par la suite à faire cavalier seul. Il a trouvé sa marque avec la sortie de RaraMwe et Dans PouAwoyo, deux albums produits par Robert Aron. Les sonorités brésiliennes à l’époque s’invitent dans son œuvre. Le gentilé de Cap-Haïtien a vite senti que la musique haïtienne avait des particularités qu’on ne trouve pas dans celle du Brésil.
« C’est ainsi que j’ai commencé à approfondir mes recherches sur notre musique. J’ai été intrigué par le son qui provient du vaksin [cornets de différentes dimensions dans lequel le musicien souffle tout en percutant avec de petites baguettes]. Cela m’a pris vingt ans pour comprendre pourquoi les vaksin [qui pourraient provenir des Indiens autochtones avant la colonisation] ne s’accordaient pas à la tonalité du chanteur, quel que soit le ton, poursuivit Gifrants. Les recherches m’ont porté à codifier le concept natif à partir du mouvement et des intervalles du vaksin, juste pour donner une approche scientifique à notre musique. On peut trouver, par exemple, ces intervalles du vaksin dans certains de mes arrangements ».
Le père du concept « natif » dit avoir apporté des innovations à son approche de la musique classique haïtienne. Il s’est gardé volontairement de ne pas inclure de sonates, de concertos, de symphonies (…) dans son répertoire – plus d’une douzaine de recueils – consacré à la musique classique d’Haïti.
Sa musique est donc très dissonante. « Je ne vais pas dénier cette symbiose culturelle qui a existé avec les autres [Européens : Français, Anglais et Espagnols]. Je me suis toutefois dit que du fait que nous avons acquis notre indépendance de sitôt [1804] dans l’histoire de l’humanité, il faut que nous ayons notre propre vision de la vie, une conception propre de notre existence. L’évaluation de cette identité ne doit pas se faire selon des repères occidentaux. Nous sommes avant tout des descendants d’Afrique. Cette identité doit se révéler dans toute son authenticité », précise Gifrants.
Cette liberté des Haïtiens acquise au prix du sang ne doit pas être uniquement corporelle, mais elle doit être tout autant intellectuelle et spirituelle, plaide le musicien. Ce qui explique, dit-il, son attachement au vodou haïtien qui incorpore tout : religion, culture, médecine et philosophie.
C’est avec un verbe mordant qu’il a abordé le legs de ses aïeux. « Nos ancêtres nous ont laissé trois éléments symboliques : un pays (Haïti), une langue (créole) et une foi (vodou). Nous n’avons rien fait avec. Le pays, on ne s’en occupe pas; la langue, on a pris 200 ans avant qu’elle soit officiellement acceptée; et le vodou est souvent démonisé », se lamente-t-il.
Cette manière de voir notre vie est erronée, juge celui qui a pris des cours de chant aux États-Unis pour peaufiner le savoir musical acquis sur le tas. Il proposa sa démarche réflexive, une redéfinition de « l’haïtianisme à partir du passé glorieux qu’ont vécu nos ancêtres, mais aussi des Haïtiens qui prospèrent un peu partout dans le monde pour redresser cette situation exécrable, voire honteuse ».
Dans sa quête de « l’âme noire », par le biais de la musique classique haïtienne, le chansonnier-compositeur-arrangeur-instrumentiste chante les vertus des divinités du vodou.
*Ce texte a été publié, pour la première fois dans les colonnes du Nouvelliste, le 22 août 2017 est légèrement remanié dans cette publication.