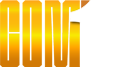Candidate au doctorat à l’École de travail social de l’Université d’Ottawa, Kharoll-Ann Souffrant est rédactrice invitée de la quatorzième édition de COM1. Le présent article est une version adaptée d’un texte paru dans le numéro 101 de la revue sociale et politique À Bâbord! (Automne 2024), pp. 22-23.
Par Kharoll-Ann Souffrant
Lorsque le magazine l’Actualité a publié son palmarès des 100 personnalités les plus influentes du Québec pour l’année 2024, j’ai eu l’impression de vivre un énième jour de la marmotte. Parmi celles et ceux « qui façonne[nt] le Québec d’aujourd’hui et prépare[nt] celui de demain », on retrouvait 34 femmes pour 67 hommes, 75 personnalités de plus de 50 ans et près de 90% de personnes blanches. Aucune personne noire ne figurait dans la fameuse liste. Celle-ci a été constituée sur la base de trois critères : le pouvoir de l’institution, le charisme et la personnalité, et la volonté de changer les choses.
Ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’il y a indignation face à celles et ceux que l’on choisit « d’oublier » parmi les figures marquantes de l’histoire de cette province. Cela étant dit, au sein des communautés minorisées, les mêmes dynamiques d’effacement sont souvent reproduites.
« L’universel » contre les « récits de niche »
En 1998, dans le cadre de l’émission Uncensored, l’écrivaine nobelisée Toni Morrison a répondu de façon incisive à la journaliste australienne Jana Wendt qui lui avait candidement demandé à quel moment elle commencerait à écrire à propos des personnes blanches dans ses romans de « manière substantielle », l’écrivaine ayant fait le choix de centrer des personnes noires dans ses écrits, à l’abri le plus possible du white gaze.
« Vous ne comprenez pas à quel point cette question est profondément raciste, le pouvez-vous ? » lui rétorqua Morrison. « Jamais vous ne demanderiez à un auteur blanc, à quel moment commencerait-il à écrire à propos des personnes noires. Votre question en elle-même provient d’un positionnement où vous êtes au centre. Il vous est inconcevable de saisir que là où je me situe est l’universel. »
Dans Feminist Theory : From Margin to Center (1984), l’intellectuelle afro-américaine Bell Hooks complexifiait déjà la notion de sororité en mettant en lumière la manière dont les féministes blanches ont trop souvent exclu les femmes noires de leurs priorités politiques. De même, pour son film Ouvrir la voix, un documentaire qui donne la parole à des femmes noires en Europe francophone, la cinéaste Amandine Gay s’est exprimée à de multiples reprises sur les barrières qu’elle a rencontrées pour financer la production de son long-métrage. Considéré par une certaine frange de l’industrie comme un « film de niche » ne pouvant pas intéresser « le grand public », Ouvrir la voix a pourtant rassemblé les foules en plus de rafler les honneurs comme le Prix du public des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) en 2017.
Lorsque l’on parle de son centre, ce que l’on exprime peut toucher les sensibilités de n’importe quel être humain. Tout comme lorsque l’on travaille du cœur, notre place ne pourra jamais nous être dérobée. Il est donc particulier de croire que les lectures que font les femmes ne peuvent pas nous offrir un éclairage sur le monde dans ses multiples dimensions, et ce, au bénéfice de tous.
Compétition et exclusion
Malheureusement, le désir d’être « inclus » dans des espaces majoritaires blancs peut encourager des dynamiques de compétition pouvant mener à l’exclusion de nos aînées, de nos contemporaines et de notre relève. En 1979, Toni Morisson exprimait sa vive inquiétude dans Cinderella’s Stepsisters, un discours poignant nous appelant à ne jamais oublier la fonction première de la liberté, soit qu’on l’acquiert pour libérer quelqu’un d’autre que soi : « I am alarmed by the violence that women do to each other : professional violence, competitive violence, emotional violence. I am alarmed by the willingness of women to enslave other women. » La dramaturge, écrivaine et journaliste Zora Neale Hurston a popularisé l’adage voulant que « all your skinfolk ain’t your kinfolk », une manière de dire que ce n’est pas parce qu’une personne partage la même couleur de peau que soi que cela signifie qu’elle sera notre alliée naturelle.
Certes, il peut toujours y avoir des désaccords entre femmes noires. Or, il est crucial d’être solidaire de nos contemporaines, car si la vie des Noirs compte, elle doit compter véritablement. Exister uniquement dans le contexte de la mort tragique et médiatisée de l’un-e des nôtres n’est pas un projet de société viable à long terme. Comme l’a déjà dit la syndicaliste américaine Mother Jones « Mourn the dead, fight like hell for the living. »
Porte-parolat et solidarités
Il est fort dangereux d’ériger des individus comme seuls porte-paroles iconiques de mobilisations collectives. Être privilégié et marginalisé ne sont pas deux choses mutuellement exclusives. Ainsi, cette façon dont la professionnalisation des luttes féministes et antiracistes, au Québec et au-delà, « centralise les marges tout en marginalisant le centre » comme l’explique avec justesse la chercheuse Khaoula Zoghlami, nous rappelle que l’introspection est un devoir qui incombe à tout être humain peu importe sa couleur ou son genre.
En somme, est-ce que l’on soutient véritablement les femmes noires, dans nos communautés et à l’abri des regards ? Celles qui sont l’incarnation matérielle de nos luttes ? Quelle est la marge et quel est le centre qui provoque notre indignation face à des palmarès comme celui de l’Actualité ? On veut être influent, certes, mais pour quoi, comment et surtout pour qui ?
| À propos de la rédactrice invitée Kharoll-Ann Souffrant est travailleuse sociale et chercheuse. Elle est chroniqueuse indépendante pour plusieurs médias québécois dont Noovo Info et la revue À Bâbord!. Elle a co-dirigé le numéro Futurités noires de la revue Possibles avec la poète, professeure et traductrice, Chloé Savoie-Bernard. En tant qu’autrice, on lui doit l’essai littéraire Le privilège de dénoncer – Justice pour toutes les victimes de violences sexuelles (Sélection du Jury du Grand Prix du Livre de Montréal 2023; Auteure de l’année – Gala Dynastie 2024). |